|
18/11/1991-2002

COMMÉMORATION
Le
18 novembre 1991, la chute de Vukovar
Après trois mois d'un siège
effroyable marqué par une résistance
héroïque, les troupes de Milosevic s'emparent
sans gloire
de la cité croate réduite en cendres
avant d'en déporter la population.
 Symbole
de la résistance croate à l’agression serbe, la ville
martyre se souvient de son calvaire et de ses milliers
de victimes. Malgré les profonds stigmates laissés
par la guerre, sa réintégration pacifique dans le giron
national en janvier 1998 couronna les efforts diplomatiques
croates et marqua le succès de la mission de l’ONU
visant à restaurer la cohabitation et la paix. Symbole
de la résistance croate à l’agression serbe, la ville
martyre se souvient de son calvaire et de ses milliers
de victimes. Malgré les profonds stigmates laissés
par la guerre, sa réintégration pacifique dans le giron
national en janvier 1998 couronna les efforts diplomatiques
croates et marqua le succès de la mission de l’ONU
visant à restaurer la cohabitation et la paix.
|
ONZIÈME ANNIVERSAIRE |
| 
Plus de 10 000 personnes venues de tout
le pays, dont Branko Borkovic, un des commandants
de la défense de la ville, ont fait le
déplacement pour participer aux cérémonies
marquant le onzième anniversaire de la
chute de la cité martyre. Parti symboliquement
de l'hôpital de Vukovar le cortège
s'est ensuite rendu au Mémorial de la
ville où sont ensevelies 646 victimes
du siège. De nombreuses personnalités
politiques, majorité et opposition confondues,
étaient également de la commémoration,
notamment Mme Antunovic, vice-premier ministre
et ministre de la Défense, M. Pancic,
ministre des anciens combattants, M. Tomcic,
président du Sabor, d'une part, et, d'autre
part, M. Sanader (HDZ), M. Budisa (HSLS) ou encore
Mme Skare-Ozbolt (DC).
|
Comme
chaque année depuis 1991, le 18 novembre, la Croatie
se souvient de la tragédie de Vukovar, ville martyre,
symbole de la résistance de tout un pays. Jadis
port fluvial prospère situé sur les rives du Danube,
à l’extrémité est de la Croatie, en Slavonie
orientale, Vukovar comptait 45 000 habitants
avant la guerre.
Étape obligée dans l’entreprise de conquête de la Croatie,
la cité baroque devient en août 1991 l'une des premières
cibles de l’armée yougoslave et des milices serbes
aux ordres de Slobodan
Milosevic, aujourd’hui jugé à La
Haye pour génocide et crimes contre l’humanité.
Résolue à rapidement soumettre la ville pour poursuivre
son avancée vers l’intérieur de la Croatie,
à l'ouest, la hiérarchie militaire serbe amasse
des moyens considérables : 35 000 hommes,
600 blindés, appuyés par des escadrilles de chasseurs
bombardiers et des navires de guerre.
 Très
vite pris au piège dans la ville assiégée, les habitants
y improvisent la résistance avec quelque 1200
volontaires légèrement armés. Faisant preuve d’un héroïsme
aujourd’hui légendaire, ils infligent de lourdes pertes
à l’agresseur, qui y perdra entre 6000 et 8000 hommes,
quelque trois cents blindés, chars et transports
de troupe, une centaine de véhicules militaires,
plusieurs batteries d'artillerie et rampes de lance-roquettes
multiple, un navire de guerre, 29 chasseurs-bombardiers
et 1 hélicoptère de combat. Au prix de
sacrifices surhumains, ils parviennent contre toute
attente à repousser les assauts répétés d’une armée
yougoslave et de paramilitaires serbes de plus en plus
en proie au doute. Au terme d’un siège implacable qui
aura duré trois mois, l’armée yougoslave, écrasant
littéralement la ville sous des centaines de
milliers de bombes et de projectiles de toutes sortes,
investira finalement le 18 novembre 1991 une ville
réduite en cendres. Très
vite pris au piège dans la ville assiégée, les habitants
y improvisent la résistance avec quelque 1200
volontaires légèrement armés. Faisant preuve d’un héroïsme
aujourd’hui légendaire, ils infligent de lourdes pertes
à l’agresseur, qui y perdra entre 6000 et 8000 hommes,
quelque trois cents blindés, chars et transports
de troupe, une centaine de véhicules militaires,
plusieurs batteries d'artillerie et rampes de lance-roquettes
multiple, un navire de guerre, 29 chasseurs-bombardiers
et 1 hélicoptère de combat. Au prix de
sacrifices surhumains, ils parviennent contre toute
attente à repousser les assauts répétés d’une armée
yougoslave et de paramilitaires serbes de plus en plus
en proie au doute. Au terme d’un siège implacable qui
aura duré trois mois, l’armée yougoslave, écrasant
littéralement la ville sous des centaines de
milliers de bombes et de projectiles de toutes sortes,
investira finalement le 18 novembre 1991 une ville
réduite en cendres.
 |
| Vukovar
avant et après la guerre. |
| |
 |
| Vukovar
reçut en treize semaines plus de bombes
et d'obus que toute l'ancienne Yougoslavie au cours
de la Seconde Guerre mondiale. |
Néanmoins,
le retard pris par l'armée serbe à Vukovar
permettra à la Croatie d'organiser sa défense.
En outre, le prix exorbitant payé par l'agresseur,
décidé à soumettre la ville en
dépit de toute logique militaire, le dissuadera
de recommencer avec d'autres villes croates. De fait,
la ligne de front se stabilisera à l'entrée
des villes croates, l'armée serbe n'étant
parvenue à conquérir que des campagnes.
Aussi est-il légitime de penser que l'extraordinaire
résistance de Vukovar a épargné
la guerre à la majeure partie du territoire
croate.
Au
lendemain de la prise de la ville, on dénombrait
parmi les habitants de Vukovar, quelque 2000 morts,
dont plus d'un quart de "défenseurs
de la ville" (soldats, policiers et volontaires,
avec une proportion non négligeable de femmes),
près de 1400 disparus
(*) et 2500 blessés.
Parmi
les survivants, jusqu’alors terrés dans les caves,
quelque 22 000 seront alors déportés vers des
camps en Serbie (Begejci, Stajicevo, Prison militaire
de Belgrade, Sremska Mitrovica, Novi Sad, Bubanj Potok,
Sid, Nis) et condamnés aux travaux forcés,
où beaucoup seront torturés et victimes
de sévices. En tout quelque 8000 Croates, dont
la moitié originaires de Vukovar, partageront
ce sort. Si par la suite la plupart ont été
libérés, beaucoup sont aujourd'hui encore
portés disparus. Parmi
eux, Jean-Michel Nicolier, jeune Français de
25 ans originaire de Vesoul, qui, dans un élan
de solidarité aussi généreux que
désespéré, avait rejoint les défenseurs
de la ville.
 Malgré
la présence du CICR et des observateurs européens,
au mépris du droit humanitaire des centaines de prisonniers,
parmi lesquels les blessés
de l’hôpital, sont abattus et ensevelis dans de
nombreuses fosses communes. Toute la Slavonie orientale
est alors soumise par l'occupant et vidée de
sa population non-serbe. Vukovar - quatre ans avant
Srebrenica - devient alors synonyme du plus grand crime
commis en Europe après 1945. Malgré
la présence du CICR et des observateurs européens,
au mépris du droit humanitaire des centaines de prisonniers,
parmi lesquels les blessés
de l’hôpital, sont abattus et ensevelis dans de
nombreuses fosses communes. Toute la Slavonie orientale
est alors soumise par l'occupant et vidée de
sa population non-serbe. Vukovar - quatre ans avant
Srebrenica - devient alors synonyme du plus grand crime
commis en Europe après 1945.
Pari
gagné
Cinq
ans plus tard, en novembre 1995, le Tribunal pénal
international de La Haye finira par inculper de crimes
contre l’humanité trois officiers généraux de l’armée
yougoslave, Mile Mrksic,
Veselin Sljivancanin et Miroslav Radic, pour l’exécution
à Ovcara des deux cents blessés de l’hôpital
(cf. actes d’accusation 1
et 2).
Après la reddition du premier accusé
en mai 2002, Belgrade s'est finalement décidé
en 2003 à extrader les deux autres inculpés
à la justice internationale.
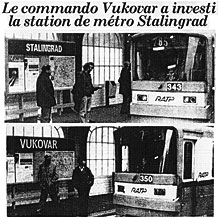 |
Pour
protester contre l'occupation de Vukovar, ville
emblématique de la résistance croate,
et alerter l'opinion publique française
sur les traitements inhumains infligés
à ses habitants, tués ou déportés
par l'armée serbe, une cinquantaine de
jeunes
Croates ont symboliquement rebaptisé
"Vukovar" la station de métro
Stalingrad, à Paris, le 20 novembre
1991. |
A
l'été 1995, au lendemain de la libération
victorieuse de la plupart des territoires occupés,
les autorités croates, bien que redoutant le
maintien du statu quo susceptible de conduire
à terme à la perte définitive
de cette région, n'en font pas moins le pari audacieux
de réintégrer cette région par des moyens pacifiques,
avec l’aide de la communauté internationale. Ce
sera finalement chose faite en juste deux ans, soit
seulement six ans après la prise de la ville. Le retour
de la Slavonie orientale dans le giron national, le
15 janvier 1998, marque enfin l’établissement
de la souveraineté nationale sur l’ensemble du territoire
croate.
Pour
y parvenir, il aura fallu le déploiement de 1996 à
1998 d’une force de paix internationale, l’ATNUSO,
la tenue d’élections municipales sous contrôle d’observateurs
extérieurs auxquelles participent les réfugiés croates,
la mise sur pied de patrouilles de police mixtes, composées
de fonctionnaires croates et serbes, afin, simultanément,
de favoriser le retour des réfugiés croates et d’endiguer
le départ des Serbes, qui constituent dans cette région
une forte minorité.
Au cours des deux ans d’administration onusienne et
malgré les nombreuses difficultés rencontrées, les
premiers réfugiés, croates pour la plupart, commencèrent
à rentrer afin de reprendre possession de leurs maisons
détruites en 1991.
Hélas,
le marasme économique qui accable toute une région
dont les infrastructures ont été lourdement endommagées
ne permet pas d'espérer voir s'accélérer
ce mouvement. La population croate, qui formait naguère
la majorité relative des habitants de la cité,
avant d'être déportée en 1991,
est au fur et à mesure des retours des personnes
déplacées redevenue majoritaire, tandis
que la communauté serbe représente un
tiers des 32 000 citoyens de la ville, selon le recensement
de 2001. Dans
l’ensemble de la Slavonie orientale les trois-quarts
des Serbes ont choisi d'y rester depuis le retour des
ces territoires à la Croatie (sur environ 67 000
avant la guerre) tandis que dans le même temps
la moitié des Croates ont pu retourner chez eux (sur
environ 86 000) après huit ans d'exil.
 Pour
la Croatie, où les deux tiers du parc immobilier détruit
pendant la guerre ont d'ores et déjà été rebâtis, la
ville de Vukovar, unique port croate sur le Danube,
figure en tête des priorités de reconstruction.
Plus de dix ans après son martyre, Vukovar se veut
le symbole des efforts conjoints accomplis par la Croatie
et la mission de l’ATNUSO - l'une des seules missions
de l'ONU dont le mandat fut accompli dans les délais
et couronné de succès - pour qu’enfin
la paix et la réconciliation s’enracinent dans cette
partie de l’Europe. Au-delà de l'espoir suscité
dans la région, le succès de Vukovar,
compte tenu de la rapidité de la réconciliation,
de l'absence d'incidents majeurs, peut légitimement
servir d'exemple de manière plus large, de Portadown
à Jérusalem. Pour
la Croatie, où les deux tiers du parc immobilier détruit
pendant la guerre ont d'ores et déjà été rebâtis, la
ville de Vukovar, unique port croate sur le Danube,
figure en tête des priorités de reconstruction.
Plus de dix ans après son martyre, Vukovar se veut
le symbole des efforts conjoints accomplis par la Croatie
et la mission de l’ATNUSO - l'une des seules missions
de l'ONU dont le mandat fut accompli dans les délais
et couronné de succès - pour qu’enfin
la paix et la réconciliation s’enracinent dans cette
partie de l’Europe. Au-delà de l'espoir suscité
dans la région, le succès de Vukovar,
compte tenu de la rapidité de la réconciliation,
de l'absence d'incidents majeurs, peut légitimement
servir d'exemple de manière plus large, de Portadown
à Jérusalem.

(*)
En 1994, la Croatie recherchait officiellement 3052
personnes portées disparues, dont 1356 pour
le seul comté de Vukovar (Vukovar et ses alentours).
Depuis, le cas de 1770 disparus a été
élucidé (qu'ils soient retrouvés
morts ou vivants), dont 772 cas pour le comté
(zupanija) de Vukovar. En 2003, la Croatie recherche
encore 1282 portés disparus, dont 584 pour le
comté de Vukovar. L'identification de 583 corps
est en cours.
|