|
25/09/2003
CONFÉRENCE
La
candidature croate à l'UE
A
l'invitation de Mme Catherine Lalumière, présidente
de la Maison de l'Europe, vice-présidente du Conseil de
l'Europe, et ancienne secrétaire générale du Conseil de l’Europe,
M. Bozidar Gagro, ambassadeur de Croatie en France, a donné
une conférence dans laquelle il a exposé pourquoi,
comment, avec quels atouts et quels espoirs la Croatie s’est-elle
décidée à poser sa candidature à l'entrée
dans l'Union européenne.
La
Croatie,
nouveau pays candidat
à l’entrée dans l’Union européenne
Conférence
de S. E. M. Bozidar Gagro,
Ambassadeur de Croatie en France
-
Maison de l'Europe -
Paris, le 25 septembre 2003
Madame la Présidente,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
C’est, si vous me le permettez, en bonne
logique que la Maison de l’Europe a invité l’ambassadeur
de Croatie à présenter son pays du point de vue
de sa candidature à l’Union européenne, après
avoir donné cette chance à ceux dont l’adhésion
est désormais acquise. Et je l’en remercie d’autant
plus chaleureusement.
En effet, à l’heure actuelle, tout
le monde s’accorde à dire que l’élargissement
de l’UE n’est pas terminé, que c’est
un processus qui se poursuit et qui concerne au moins deux pays
candidats – à savoir, la Roumanie et la Bulgarie,
pressenties pour être intégrées en 2007 –
mais également un autre candidat, la Turquie, dont le cas
est toujours débattu, ainsi que les pays de l’Europe
du Sud-Est, regroupés techniquement sous la dénomination
circonstancielle de « Balkans occidentaux », et dont
la vocation à intégrer l’UE est désormais
reconnue. Or, parmi ceux-là, la Croatie est le seul pays
qui ait traduit sa vocation en acte de candidature, laquelle,
d’un point de vue formel, ne restera que potentielle jusqu’à
ce qu’elle soit avalisée par Bruxelles, conformément
à la procédure habituelle.
Pourquoi, comment et avec quels atouts et quels
espoirs la Croatie s’est-elle décidée à
poser sa candidature ? Voilà les questions auxquelles je
tenterais d’apporter quelques réponses.
| LA
CROATIE - UNE POSITION CHARNIÈRE |
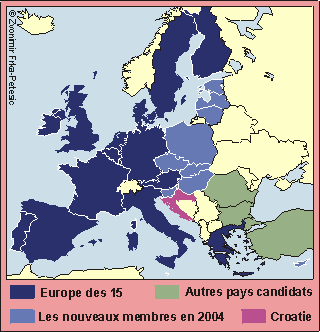 |
Tout d’abord, il y a une réalité
géographique : la Croatie
se trouve presque au cœur même de l’Europe, à
l’ouest de sa partie orientale formée par la Roumanie,
la Bulgarie et la Grèce, à l’ouest des autres
pays balkaniques, au carrefour de trois grandes aires : de la
Méditerranée, de l’Europe centrale et de l’Europe
de l’Est. Cette position géographique n’est
pas qu’un simple attribut, mais identifie avant tout son
rôle sur le plan des communications, des échanges
économiques et de l’interpénétration
culturelle.
Sur le plan historique, l’appartenance
européenne de la Croatie est en partie obnubilée
par son passé récent, celui du XXe
siècle, période au cours de laquelle elle a
fait partie de la Yougoslavie, État créé
et défait par la force de l’histoire, État
qui n’a existé que soixante-douze ans. Un temps relativement
court comparé aux trois siècles qu’a duré
l’État indépendant croate du Moyen–Age,
mais aussi aux longs siècles de sa continuité au
sein de différents royaumes et empires européens,
d’abord celui des Hongrois, puis celui des Anjou franco-napolitains,
enfin celui des Habsbourg autrichiens puis austro-hongrois.
Par ailleurs, il convient de noter que la notion
même de Balkans, au sens politique du terme, et que l’on
oppose volontiers à l’identité européenne,
est une invention récente, liée aux événements
de la fin du XIXe et du XXe siècle, et qui est tout naturellement
vouée à être bientôt reconsidérée
dans la perspective de la recomposition européenne globale
qui s’annonce.
Quoi qu’il en soit, la renaissance d’une
Croatie indépendante,
acquise dans le sang et les larmes, s’est accompagnée
d’une certaine volonté de mettre en relief les liens
historiques et culturels multiples entretenus avec l’Occident.
Mouvement à l’opposé de celui qui, du temps
de la Yougoslavie, tentait – parfois de manière artificielle
voire abusive – de renforcer la cohésion interne
aux dépens des liens historiques réels qui avaient
ancré ses différentes entités dans d’autres
ensembles régionaux.
Un européanisme à toute
épreuve
Or, un projet politique capital comme celui de
l’adhésion d’un pays, en l’occurrence
de la Croatie, à l’Union européenne, n’est
guère, bien sûr, le produit de simples constats géographiques
et de considérations historicistes ; il en est, cependant,
en partie tributaire : il lui donnent les points de départ
et les cadres généraux. Mais les vrais mobiles se
trouvent dans la vie des citoyens, dans leurs aspirations à
la paix, à la sécurité, au progrès,
au bien-être et au désir de renouer avec leur racines
européennes. Et la vraie chance, dans le temps vécu,
réel.
Malgré les velléités isolationnistes
portées par un nationalisme prononcé qui caractérisa
les années de la guerre d’indépendance et
celles du retour à la paix, le projet européen constitua
le seul projet politique sérieux depuis la création
du jeune État croate. Et tandis que le pays fut agressé
et en partie occupé, les traumatismes causés par
la guerre portaient tous les espoirs vers le large européen,
communauté de pays prospères, dynamiques et civilisés.
Si en Croatie la finalité fut toutefois toujours claire,
les moyens et les voies susceptibles de mener le pays vers cet
objectif l’étaient beaucoup moins. Les difficultés
matérielles et leurs conséquences sociales étaient
énormes, surtout si l’on tient compte du fait que
les autorités politiques devaient simultanément
gérer la reconstruction du pays meurtri par la guerre,
le retour des réfugiés
et des personnes déplacées, la transition vers
une économie de marché et la modernisation de la
société. Et tout en multipliant les déclarations
de principe censées accréditer sa bonne volonté
et sa disposition à coopérer avec la communauté
internationale, le pouvoir en place à Zagreb des années
1990, autoritaire et peu soucieux des impératifs démocratiques,
inspirait de moins en moins confiance tant aux pays de l’UE
qu’à ceux de l’Alliance atlantique, deux organisations
pourtant essentielles.
Signes avant-coureurs
Aussi un grand changement s’est-il produit
aux élections parlementaires du 3 janvier 2000, lorsque
le parti au pouvoir, fondé par l’ancien président
Tudjman, fut remplacé
par un gouvernement de coalition, porteur de l’espoir du
renouveau. Quelques semaines après, l’élection
à la tête de l’État de Stipe
Mesic, opposant au régime de Tudjman, achevèrent
ce revirement. L’événement eut un retentissement
immense, d’autant plus que l’alternance politique
s’est effectuée de manière tout à fait
démocratique. Sa portée ne se mesurait pas uniquement
quant à ses conséquences intérieures ni à
ses perspectives d’évolution, mais elle s’évaluait
également quant à son impact sur les pays de la
région, où la situation demeurait précaire.
La chute de Milosevic à Belgrade, la manière dont
les choses se sont déroulées en Bosnie-Herzégovine
et même au Kosovo, ont donné raison à ceux
qui avaient reconnu dans le changement démocratique en
Croatie le signe avant-coureur d’une évolution régionale
positive. Ce fut d’ailleurs le point de départ de
l’action des Quinze en faveur des pays du Sud-Est européen
restés en dehors de processus d’intégration
communautaire, action qui devait se traduire par la tenue, fin
novembre 2000, du Sommet de Zagreb.
Du Sommet de Zagreb à celui de
Salonique
Bien que la première formulation positive
fût faite à la réunion de Feira, le Sommet
de Zagreb, organisé sous la présidence française,
restera comme un moment-clé dans la conception de la politique
de l’Union à l’égard des pays qui seront
désormais souvent désignés comme les «
Balkans occidentaux ». A Zagreb un cadre fut établi
autour de trois idées-forces : reconnaissance des perspectives
européennes des pays issus de l’ancienne Yougoslavie
et de l’Albanie, mise en place du Processus de stabilisation
et d’association (PSA) – un programme spécifique
adapté à la situation de ces pays –, et surtout,
mise en application de deux critères d’évaluation
des progrès de ces pays : le premier, individuel, mesure
au cas par cas les résultas de chacun ; le préservant
du risque de se trouver tributaire des résultats des autres,
le second, complémentaire, évalue la contribution
que chaque pays est censé apporter à la stabilité,
à la coopération et au progrès de la région.
A cela s’ajoutent les critères dits de Copenhague,
critères de base que chaque candidat à l’adhésion
en UE doit satisfaire.
Entre le Sommet de Zagreb, en novembre 2000, et
le Sommet de Salonique,
qui s’est tenu en juin dernier et fut en partie consacré
aux pays du PSA, une évolution considérable s’est
produite du côté des pays concernés. Malgré
cela, au niveau de la politique de l’Union, c’est-à-dire
des conditions que les pays de la région doivent satisfaire
et des principes de leur admission, les évolutions enregistrées
se résument à quelques subtiles nuances de vocabulaire
: un peu plus de clarté sur les perspectives d’adhésion,
puisque les anciens candidats dits « potentiels »
sont désormais désignés comme de vrais candidats
« dès qu’ils auront rempli les conditions nécessaires
» ; un peu plus de précision quant au Processus de
stabilisation et d’association, défini comme condition
préalable indispensable, même en cas d’ouverture
de négociations avec un pays sur la base de sa candidature.
Dans l’atmosphère de préparatifs
accélérés et d’âpres négociations
qui ont précédé le « Big bang »
de l’élargissement de Copenhague,
le Sud-Est européen s’est quelque peu trouvé
oublié. Les discussions enflammées de l’automne
dernier ont avant tout porté sur les frontières
extérieures de la future Union, sur les arguments en faveur
ou contre l’adhésion de la Turquie, si bien que,
selon les cas, on portait à 27 ou à 28, le nombre
de membres de l’Union élargie dans un avenir prévisible,
faisant ainsi peu de cas de pays, comme la Croatie, qui se trouvent
pourtant presque au cœur géographique de l’Europe.
La candidature croate
Et c’est une erreur d’appréciation
que seule la peur du bouleversement du nombre des pays membres
de l’Union saurait éventuellement excuser. D’abord
parce que tous ces pays, Serbie et Monténégro et
Bosnie-Herzégovine inclus, avaient d’ores et déjà
affiché leurs ambitions européennes. Le projet européen
est devenu le seul projet politique digne de ce nom dans la région.
Tandis que la Croatie, convaincue de pouvoir très rapidement
satisfaire aux normes du PSA, forte de son potentiel économique,
de sa stabilité intérieure et déterminée
à en finir avec les quelques questions encore en suspens,
mûrissait sa décision d’engager la procédure
de candidature. Le 21 février dernier, c’était
chose faite : le Premier ministre croate Ivica
Racan s’est rendu à Athènes pour remettre
au président de l’Union européenne en exercice,
Costas Simitis, la demande
d’adhésion de notre pays à l’Union.
On a longuement insisté sur le contexte
régional et son évolution pour la simple raison
qu’il reste « essentiel » dans l’optique
de l’Union, comme la Déclaration de Salonique venait
de le rappeler. En Croatie, laquelle qui venait à peine
de se dégager d’une expérience qui lui laissait
de mauvais souvenirs, la politique régionale de l’Union
définie dès 1997 ressemblait fort à un nouveau
regroupement sous contrainte. Sans que cette appréhension
ne disparaisse complètement, grâce à l’action
réfléchie du gouvernement de centre-gauche et, surtout
du Président de la République qui multiplia ces
déplacements et ses prises
de position positives, l’opinion publique s’est
finalement rallié à la thèse selon laquelle
seule la stabilité, le progrès et l’orientation
européenne effectives de ses voisins peuvent être
profitable à la Croatie. Aussi, la Croatie s’est-elle
engagée alors à bon escient et avec conviction dans
ce cercle vertueux.
L’accélération du processus
européen qui a finalement abouti à la demande d’adhésion,
s’appuyait, d’un côté, sur une opinion
publique favorable dans des proportions comprises entre 75 et
80 %, et de l’autre, sur les analyses comparatives démontrant
les capacités de la Croatie par rapport aux pays qui font
partie de l’actuelle vague d’élargissement
et, surtout, comparé à ceux dont l’intégration
est prévue à l’horizon de 2007. Rappelons
qu’à la fin des années 80, la Croatie se trouvait,
avec la Slovénie, en tête du peloton des pays en
transition et que son retard par rapport à certains pays
comparable est dû avant tout aux conséquences de
la guerre subie tout au long des années 90.
Unanimité politique
Toute la classe politique croate fut donc unanime
pour enclencher les mécanismes de candidature, pour essayer,
éventuellement, de rattraper le prochain train de l’élargissement,
en 2007. Au lendemain du sommet historique de Copenhague, le 18
décembre 2002, le Sabor,
le Parlement croate, vota une résolution enjoignant au
gouvernement de soumettre formellement une demande d’adhésion,
et cela dans les meilleurs délais possibles. Une sorte
d’effervescence s’est alors emparée de la scène
politique, des médias, ainsi que les ministères
qui ont reçu les consignes de mobilisation, en vue d’une
vaste harmonisation des normes et des lois, par ailleurs déjà
entreprise dans le cadre du PSA.
| La
demande d’adhésion croate repose aussi bien
sur une opinion publique favorable à près
de 80 % que sur les bons résultats de la Croatie
comparés non
seulement aux pays dont l’intégration est prévue
en 2007,
mais également à ceux
de l’actuelle vague d’élargissement.
|
Tenant compte de la lassitude qui prévalait
après les efforts du dernier élargissement, et surtout,
des incertitudes de fonctionnement qui planent sur l’avenir
proche de l’Union à 25, la diplomatie croate craignait
une attitude réticente, à l’annonce de la
demande de Croatie, aussi bien de la Commission de Bruxelles que
des pays membres. Tout en ne contestant pas le droit de la Croatie
à poser sa candidature ni certains de ses atouts incontestables,
des voix sceptiques invoquèrent les difficultés
du timing, la complexité des procédures et, surtout,
quelques problèmes de caractère politique à
régler au préalable. Au fond, la vraie réserve,
rarement, avouée concernait la région, ce fameux
contexte régional tant redouté chez les Croates,
où certains pays ayant des problèmes beaucoup plus
graves, et des performances plus modestes que la Croatie, pouvaient
lui emboîter le pas.
Mobilisation sans précédent
Or, la détermination et la clarté
des motifs et des objectifs de la Croatie ont provoqué
une surprise positive. Côté procédure, le
Conseil autorisa le 14 avril 2003 la Commission à préparer
un avis, ce qui prend, en moyenne,
un an. Le président de la Commission Romano
Prodi s’est rendu en personne à Zagreb le 10
juillet dernier pour remettre au gouvernement un questionnaire
de plus de 4 000 rubriques, une mission de routine, mais le geste,
inhabituel, fut apprécié, comme signe d'encouragement
et de confiance. Dans deux semaines, le 9 octobre prochain, le
Premier ministre Racan rendra la courtoisie à M. Prodi
en lui remettant à Bruxelles les réponses au questionnaire,
qui serviront aux spécialistes de la Commission à
analyser l'aptitude de Croatie à figurer en tant que candidat
officiel et d'entamer dès le mois d’avril 2004 –
espère-t-on – les négociations, à proprement
parler, sur l’adhésion.
Côté politique, la candidature croate,
posée de manière souveraine et responsable, eut
des répercussions sur trois niveaux : à l’intérieur
du pays elle a provoqué une mobilisation sans précédent,
dotant le pays d’un objectif majeur et précis, capable
d’orienter et absorber les forces vives pendant de longues
périodes ; sur le plan régional, elle eut un impact
très positif, redonnant des raisons d’espérer
que le clos balkanique n’est pas fatalement fermé
et qu’une dynamique favorable pourrait conduire chacun de
ces pays à rejoindre l’Europe réunifiée.
Ainsi les présidents de cinq pays des « Balkans occidentaux
» ont-ils multiplié les signes de solidarité
réciproque aussi bien que les déclarations communes
; enfin, avec la Croatie frappant à leur porte, les instances
européennes seront-elles peut-être portées
à revoir leur stratégie attentiste et à s’investir
d’avantage dans la solution des problèmes des pays
restants.
Des élections sous le signe de
l'Europe
En revenant sur les raisons de l’assurance
avec laquelle la Croatie s’est lancée dans le processus
d’intégration européenne, il faut souligner,
en premier lieu, sa sécurité et sa stabilité
politique. Bien qu’il existe quelques différends
frontaliers mineurs avec les voisins, les vestiges de la désintégration
de l’ancienne Yougoslavie, la Croatie est en paix avec ses
voisins et développe avec eux des relations de bon voisinage,
de coopération et d’amitié. Les séquelles
de la guerre sont progressivement éliminés. La première
alternance politique réussie, nous sommes persuadés
que les prochaines élections parlementaire qui auront lieu
dans deux mois, quels qu’en soient les vainqueurs, ne changeront
pas le cap des réformes entreprises, surtout celles liées
au programme européen. J’en veux pour preuve le fait
que, dans ses slogans préélectoraux, le principal
parti d’opposition promet aux électeurs d’intégrer
la Croatie à l’Europe plus vite que ne serait en
mesure de le faire, selon lui, l’actuel gouvernement auquel
pourtant chacun reconnaît qu’il a mené une
politique résolument engagée dans la voie européenne.
Les problèmes politiques qu’évoquent
les observateurs internationaux plus ou moins officiels ne sont
pas structurels, sauf peut-être un seul : celui de la justice,
ou plutôt du système judiciaire, problème
que connaissent presque tous les pays en transition. Et même
celui qui est souvent pointé et qui est lié à
la coopération avec le Tribunal de la Haye, se réduit
à l’heure actuelle au seul cas d’un général
fugitif, et qui sera instantanément résolu le jour
de son interpellation ou de sa réédition. L’autre
question concerne le retour
des réfugiés serbes. Vu les efforts que le gouvernement
a déployé, il est en passe de devenir caduc d’ici
quelques mois.
Atouts économiques
Même les observateurs les plus critiques
s’accordent à dire que la Croatie dispose dans le
secteur économique d’atouts relativement importants,
avec un PIB en croissance stable (5,2% l’année dernière,
4,7% cette année – selon les récentes estimations
du FMI), un tourisme en pleine expansion, un taux d’inflation
de 2 %, un chômage en net recul. Malgré une dette
extérieure importante, les lenteurs et les tâtonnements
de la privatisation, un trop cher coût du travail, le manque
de transparence de la législation qui fait quelquefois
hésiter les investisseurs étrangers, il est permis
de croire à un avenir plus radieux. Mais avec un PIB per
capita de 5140 euros, la Croatie devance largement non seulement
tous les pays du PSA et les candidats au prochain élargissement,
mais aussi une bonne partie des pays qui rejoindront l’Union
au 1er mai 2004.
Enfin, depuis la signature du PSA, en octobre
2001, la Croatie a fait un grand pas dans le laborieux domaine
de l’harmonisation des normes de l’acquis communautaire.
Au rythme selon lequel nous progressons, nous sommes sûrs
d’achever la majeure partie du travail d’ici 2006.
Sera-ce suffisamment tôt pour s’embarquer dans le
prochain train de l’élargissement annoncé
pour 2007 ? Nous le verrons.
Quoi
qu’il en soit, se donner des buts précis, mobilisateurs,
contraignants même, c’est corroborant, et certainement
positif. Ainsi la Croatie s’est-elle décidée
d’entrer dans le jeu des mécanismes, des règles
et des délais. Mais à présent une approche
plus sereine domine l’effort entrepris par le pays, ainsi
que ses attentes et ses espoirs. Certes, l’horizon 2007
est séduisant, nous nous sentons en mesure de l’atteindre
et nous ne nous désisterons pas. Mais ce n’est pas
une date butoir ni un délai fatidique. L’essentiel,
c’est ce qui se passera entre-temps : la Croatie va se transformer,
elle veut se transformer, elle vivra, et évoluera selon
les valeurs qu’elle a choisi, et qui vont guider et éclairer
son avenir d’une manière ou d’une autre.
Je
vous remercie de votre attention.
|