26/06/2001

HISTOIRE
La France et la question croate
A l'occasion de la publication aux Editions Peter Lang
de la thèse de Miro Kovac, docteur en histoire de la Sorbonne Nouvelle,
"La France, la création du royaume 'yougoslave' et la question
croate, 1914-1929", le Centre de recherche Défense et Diplomatie
dans le Monde Contemporain (DDMC) de la Sorbonne Nouvelle organise, avec le
concours du Service culturel de l'ambassade de Croatie à Paris, une présentation
du livre.
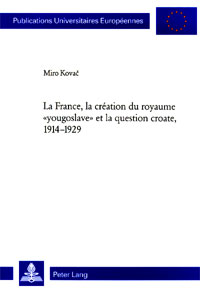 Au
lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que le principe des nationalités
et la politique française avaient triomphé sur le continent européen,
les conditions pour l'émancipation politique des Croates par un "couplage"
avec la France républicaine étaient théoriquement réunies.
Or, cette conjoncture n'aboutit pas à une telle union. L'objectif majeur
de cette étude est d'exposer et analyser les raisons qui empêchèrent
sa réalisation. Y sont abordés par ailleurs les thèmes suivants:
Pourquoi et comment les Croates adoptèrent-ils le "yougoslavisme",
une idéologie politico-nationale qui prit naissance au sein de leur élite
intellectuelle? Quels sont les facteurs qui déterminèrent leur distanciation
progressive du "yougoslavisme" après l'union politique avec les
"frères" sud-slaves? Quel rôle joua la Troisième
République dans l'accomplissement de l'unification sud-slave durant et
au lendemain de la Grande Guerre? Comment percevait-on depuis Paris le mécontentement
et les tendances émancipatrices croates? Pourquoi la France tenait-elle
si fermement à l'alliance exclusive avec l'hégémonique Belgrade,
tout en ignorant les plaintes de Zagreb, le deuxième centre politique du
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes? Telles sont les principales questions
auxquelles ce travail, fondé largement sur des sources d'archives françaises,
s'efforce d'apporter des réponses. Au
lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que le principe des nationalités
et la politique française avaient triomphé sur le continent européen,
les conditions pour l'émancipation politique des Croates par un "couplage"
avec la France républicaine étaient théoriquement réunies.
Or, cette conjoncture n'aboutit pas à une telle union. L'objectif majeur
de cette étude est d'exposer et analyser les raisons qui empêchèrent
sa réalisation. Y sont abordés par ailleurs les thèmes suivants:
Pourquoi et comment les Croates adoptèrent-ils le "yougoslavisme",
une idéologie politico-nationale qui prit naissance au sein de leur élite
intellectuelle? Quels sont les facteurs qui déterminèrent leur distanciation
progressive du "yougoslavisme" après l'union politique avec les
"frères" sud-slaves? Quel rôle joua la Troisième
République dans l'accomplissement de l'unification sud-slave durant et
au lendemain de la Grande Guerre? Comment percevait-on depuis Paris le mécontentement
et les tendances émancipatrices croates? Pourquoi la France tenait-elle
si fermement à l'alliance exclusive avec l'hégémonique Belgrade,
tout en ignorant les plaintes de Zagreb, le deuxième centre politique du
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes? Telles sont les principales questions
auxquelles ce travail, fondé largement sur des sources d'archives françaises,
s'efforce d'apporter des réponses.
Miro KOVAC est docteur en
histoire des relations internationales et titulaire d'un DEA en politiques européennes.
Il vit à Zagreb où il est actuellement chargé de mission
pour les questions européennes et atlantiques à la Présidence
croate.
Présentation
le mardi 26 juin 2001 entre 16 h et 18 h.
Présidence de la Sorbonne Nouvelle
- Salle Bourjac, 17 rue de la Sorbonne - Paris 5e.
« La France, la création
du royaume "yougoslave" et la question croate, 1914-1929 »,
M. Kovac, Ed. Peter Lang, 2001, 398 p. 356 FRF.
 Commander
l'ouvrage chez Peter
Lang Commander
l'ouvrage chez Peter
Lang
 Commander
l'ouvrage sur Amazon.fr Commander
l'ouvrage sur Amazon.fr

Note
de lecture parue dans Relations internationales, numéro 111,
automne 2002, p.413-415.
par Renéo Lukic,
Professeur agrégé au Département d'histoire de l'Université
de Laval.
La présente
monographie est issue d'une thèse de doctorat, soutenue par Miro Kovac
à la Sorbonne en 1999. La thèse était dirigée par
le professeur Jean-Claude Allain. Elle représente un travail de pionnier
en ce qui a trait à l'histoire politique de la Croatie aux XIXe et XXe
siècles. Nous pensons que ce livre opère un déplacement du
regard de l'historien à partir d'un objet de recherche qui a monopolisé
pendant des décennies les recherches historiques, à savoir la Yougoslavie,
vers ses composantes, soit les États indépendants issus de la désintégration
de la fédération.
L'objectif
principal de cette monographie est de répondre à la question suivante:
Pourquoi, au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que le principe
des nationalités s'était imposé à la Conférence
de paix à Versailles et que "les conditions pour l'émancipation
politique des Croates par un "couplage" avec la France républicaine
était théoriquement revenues", la France a-t-elle choisi la
Serbie comme son alliée stratégique privilégiée dans
les Balkans? La réponse à cette question est apportée dans
la troisième partie du livre: "La France et le Royaume SHS face à
la question croate (1918-1929)" et nous y reviendrons.
La première
partie du livre est consacrée aux origines historiques des Croates et à
leur place en Europe centrale. Les premiers chapitres présentent l'histoire
politique des Croates du Moyen Âge jusqu'à la Première Guerre
mondiale. Les thèmes suivants sont abordés: l'union politique avec
les Magyars, l'arrivée des Ottomans et l'association des Croates à
la maison des Habsbourg. Un accent particulier est mis par l'auteur sur la formation
au XIXe siècle de deux idéologies politico-nationales concurrentes,
à savoir le "croatisme" et le "yougoslavisme", qui
ont influencé d'une manière décisive l'histoire politique
des Croates durant cette période. Le "croatisme", incarné
par Ante Starcevic, son fondateur, était une idéologie politique
ayant pris forme au XIXe et qui prévoyait la création d'un État
indépendant pour les Croates. Cependant, c'est l'adoption du "yougoslavisme"
qui a influencé l'histoire politique des Croates au XXe siècle.
La victoire du "yougoslavisme" au sein des élites politiques
croates, à la veille de la Première Guerre mondiale, a ouvert la
voie à la création du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
créé en 1918. Le désenchantement des Croates après
74 ans de vie commune avec les Serbes dans le cadre des États yougoslaves
(de la monarchie à la république) et le retour des Croates au "croatisme"
en 1990-1991, l'idéologie politique à la base des revendications
des élites politiques croates visant la création d'un État-nation
après la fin de la division de l'Europe en 1989-1990, furent les points
de ralliement de la majorité des Croates qui refusaient de vivre au sein
d'un État multinational dominé par les Serbes. Le projet politique
de Starcevic, adapté aux nouvelles circonstances historiques, a été
repris par le président Tudjman et son parti, le HDZ, pour éloigner
définitivement la Croatie du yougoslavisme qui venait de subir un coup
mortel de la part du nationalisme ethnique serbe personnalisé par Slobodan
Milosevic.
La deuxième
partie du livre couvre la période de la Première Guerre mondiale
durant laquelle une intense activité diplomatique a été menée
par des hommes politiques croates, notamment Frane Supilo et Ante Trumbic, dans
l'objectif de trouver un terrain d'entente avec le président du Conseil
serbe, Nikola Pasic, en vue de créer un État réunissant les
Slaves du Sud. Cette partie du livre examine en détail l'attitude des principaux
gouvernements alliés, en particulier celui de la France, vis-à-vis
du futur État des Slaves du Sud.
La troisième
partie du livre, à mon avis la plus originale, explique les raisons qui
ont empêché la réalisation de la rencontre historique entre
les Français et les Croates. La France, en suivant ses objectifs politiques
en Europe Centrale qui visaient à affaiblir l'hégémonie de
la Monarchie austro-hongroise, avait poussé dans un premier temps les Hongrois,
les Serbes et les Croates à s'unir politiquement pour ensuite choisir la
Serbie comme son alliée principale dans la région. En définitive,
les Croates ne faisaient pas le poids (politiquement) face à la Serbie
qui, depuis le Congrès de Berlin, était déjà une puissance
régionale. L'appui que la France a donné à l'Italie, également
son alliée dans la région, au détriment des revendications
des Croates dans l'affaire de la ville de Fiume, a rendu un partenariat politique
entre la France et les Croates peu probable (p. 363). Cette partie du livre s'appuie
presque entièrement sur les documents diplomatiques français. Nous
apprenons entre autres que la France a choisi la Serbie en tant qu'alliée
privilégiée dans les Balkans parce que, selon les élites
politiques françaises de l'époque, il incombait aux Serbes de "dégermaniser"
(p. 360) les peuples du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui avaient
vécu pendant des siècles en Autriche-Hongrie (les Croates et Slovènes).
Il est
intéressant de constater que les mêmes objectifs qui ont favorisé
le rapprochement franco-serbe durant les années 1920 et 1930, à
savoir une orientation anti-germanique du Royaume des Serbes, des Croates et Slovènes,
la co-fraternité d'armes entre Serbes et Français durant la Grande
Guerre, la croyance en la valeur de l'armée serbe ainsi que le penchant
français pour le centralisme (p. 367), étaient toujours présents
en 1990/91 au moment de la désintégration de la Yougoslavie. En
cette année fatidique pour la Yougoslavie, la France croyait à tort
que l'Allemagne, en reconnaissant l'indépendance de la Croatie et de la
Slovénie au mois de décembre 1991, désirait se tailler une
sphère d'influence dans les Balkans au détriment des intérêts
de la France. Ce fut certainement la perception du président français
François Mitterrand qui ne cacha jamais son aversion envers les Croates
et son admiration pour les Serbes.
Cette monographie
est riche et très bien documentée. Une grande partie de la recherche
a été effectuée à partir des Archives diplomatiques
du Ministère français des Affaires étrangères (ADMAE)
et du Service historique de l'armée de terre (SHAT). Ce livre avec celui
de Paul Garde (1),
représente, selon nous, la meilleure introduction en langue française
de l'histoire de la Croatie et de la Yougoslavie aux XIXe et XXe siècles.

Paul
GARDE, Vie et mort de la Yougoslavie, Paris, Fayard, 2000 (3e édition),
480 p.
|