|
20/09-5/10/2003
EXPOSITION
Zvonimir Lončarić
L’Atelier
Grognard consacre une exposition au célèbre peintre
et sculpteur croate. Hautes en couleur, ses œuvres sont légèrement
teintées d'ironie et de poésie.
 Du
20 septembre au 5 octobre, Rueil-Malmaison accueille une exposition
du peintre et sculpteur croate Zvonimir Loncaric. Avec ses couleurs
vives, souvent bleues, rouges ou jaunes, l’artiste, fortement
porté vers l'aspect ludique de son art, joue avec les volumes,
avec les corps féminins qu’il façonne et colorie.
25 sculptures en bois et polyester seront exposées
ainsi que 12 peintures. Du
20 septembre au 5 octobre, Rueil-Malmaison accueille une exposition
du peintre et sculpteur croate Zvonimir Loncaric. Avec ses couleurs
vives, souvent bleues, rouges ou jaunes, l’artiste, fortement
porté vers l'aspect ludique de son art, joue avec les volumes,
avec les corps féminins qu’il façonne et colorie.
25 sculptures en bois et polyester seront exposées
ainsi que 12 peintures.
| ZVONIMIR
LONCARIC |
|
 Né
à Zagreb le 13 mars 1927, Loncaric est originaire
de Podravina, berceau de l'art naïf croate. Après
quatre années d'études d'architecture, il
entre en 1950 à l’Académie des Arts
appliqués de Zagreb, d'où il sort diplomé
en 1955. Depuis 1958, il participe régulièrement
comme dessinateur ou scénographe aux meilleures créations
des Studios de film d'animation de Zagreb. Il est notamment
l'auteur de la scénographie du dessin animé
Surogat de Dusan Vukotic primé par un Oscar
en 1961. Loncaric est également l'auteur d'une cinquantaine
de mises en scènes de théâtre et de
films éducatifs produits à Zagreb. En tant
qu'illustrateur et graphiste, il a illustré de nombreux
livres et revues. Outre sa participation à une centaine
d'expositions collectives en Croatie et à l'étranger
(Bruxelles, Paris, Göteborg, Pekin, Athènes,
Rome, Budapest, Le Caire, etc.), une quarantaine d'expositions
lui ont été consacré depuis quarante
ans, dont plusieurs en Europe (Graz, La Haye, Clermont Ferrand).
Une vingtaine de ses sculptures en extérieur ornent
des lieux publics en Croatie, mais aussi à l'étranger
(Séoul). Trois films ont été consacrés
à son oeuvre. Il vit et travaille entre Zagreb et
le hameau de Novigrad Podravski où depuis les années
1980 il a installé en pleine campagne l'atelier de
ses rèves. Né
à Zagreb le 13 mars 1927, Loncaric est originaire
de Podravina, berceau de l'art naïf croate. Après
quatre années d'études d'architecture, il
entre en 1950 à l’Académie des Arts
appliqués de Zagreb, d'où il sort diplomé
en 1955. Depuis 1958, il participe régulièrement
comme dessinateur ou scénographe aux meilleures créations
des Studios de film d'animation de Zagreb. Il est notamment
l'auteur de la scénographie du dessin animé
Surogat de Dusan Vukotic primé par un Oscar
en 1961. Loncaric est également l'auteur d'une cinquantaine
de mises en scènes de théâtre et de
films éducatifs produits à Zagreb. En tant
qu'illustrateur et graphiste, il a illustré de nombreux
livres et revues. Outre sa participation à une centaine
d'expositions collectives en Croatie et à l'étranger
(Bruxelles, Paris, Göteborg, Pekin, Athènes,
Rome, Budapest, Le Caire, etc.), une quarantaine d'expositions
lui ont été consacré depuis quarante
ans, dont plusieurs en Europe (Graz, La Haye, Clermont Ferrand).
Une vingtaine de ses sculptures en extérieur ornent
des lieux publics en Croatie, mais aussi à l'étranger
(Séoul). Trois films ont été consacrés
à son oeuvre. Il vit et travaille entre Zagreb et
le hameau de Novigrad Podravski où depuis les années
1980 il a installé en pleine campagne l'atelier de
ses rèves. |
S’il fallait définir
en quelques termes le lien qui relie entre elles les œuvres
de Zvonimir Loncaric, qu’il s’agisse de peintures,
de sculptures ou d’affiches, plusieurs maîtres-mots
viennent d’emblée à l’esprit : humour,
joie de vivre et polychromies chatoyantes. Pour autant, ils ne
donneraient qu’une idée superficielle de son art
profondément anti-classique où la figure humaine,
sous toutes ses déclinaisons, occupe une place centrale.
Qui plus est, réduite à elle-même, elle se
trouve affranchie de tout message universel plus ou moins explicite
qu’elle aurait vocation à transmettre.
 Bien
que certains les aient rapprochées des personnages de la
Comédie humaine de Balzac, ses sculptures, qui
manifestement n’aspirent nullement à l’immortalité,
figurent avant tout une poésie de l’éphémère
dans sa forme la plus naïvement rudimentaire. Outre son modernisme
qu’illustre d’abord sa simplification des volumes
et des formes à leur quintessence même, il lui arrive
d'enrichir son style reconnaissable par l’utilisation d’effets
cinétiques produits par l’articulation mécanique
de ses œuvres. Éclectique par ses choix, la créativité
de Loncaric a fait feu de tout bois : papier, cire, argile, bois,
bronze, verre, polyester…, chaque matériau a sa noblesse,
tout est bon à expérimenter. D'aucuns y déceleront
l'influence de l'Académie des Arts appliqués de
Zagreb où il fit ses premières armes, d'autres y
verront un pionnier dans un courant artistique qui, à
certains égards, le rapproche de Niki de Saint-Phalle
ou du pop-art américain. Bien
que certains les aient rapprochées des personnages de la
Comédie humaine de Balzac, ses sculptures, qui
manifestement n’aspirent nullement à l’immortalité,
figurent avant tout une poésie de l’éphémère
dans sa forme la plus naïvement rudimentaire. Outre son modernisme
qu’illustre d’abord sa simplification des volumes
et des formes à leur quintessence même, il lui arrive
d'enrichir son style reconnaissable par l’utilisation d’effets
cinétiques produits par l’articulation mécanique
de ses œuvres. Éclectique par ses choix, la créativité
de Loncaric a fait feu de tout bois : papier, cire, argile, bois,
bronze, verre, polyester…, chaque matériau a sa noblesse,
tout est bon à expérimenter. D'aucuns y déceleront
l'influence de l'Académie des Arts appliqués de
Zagreb où il fit ses premières armes, d'autres y
verront un pionnier dans un courant artistique qui, à
certains égards, le rapproche de Niki de Saint-Phalle
ou du pop-art américain.
Si l’on eût pu croire que la perte
de l’espace et du volume constituerait un carcan insoutenable
à son imagination débordante, ce serait mal connaître
Loncaric qui s’est révélé tout aussi
à l’aise dans ses acryliques sur toile ou sur soie,
ses affiches, ses croquis pour dessins animés, ses scénographies
ou encore ses décorations d’intérieurs, qu’il
s'est montré libre dans ses sculptures. Passé maître
dans l’art de la géométrisation, il a su l’appliquer
à l’espace bidimensionnel sans pour autant faire
de ses tableaux de vulgaires épures de ses statues bariolées,
mais en préservant un indéfinissable lien entre
ces deux faces majeures de sa production artistique que sont la
peinture et la sculpture.
Exposition
du 20 septembre au 5 octobre 2003.
"Oeuvres
choisies"
Atelier
Grognard
6, avenue du
Château de Malmaison
92500 Rueil-Malmaison
Entrée libre (Ouverture de 10h à 18h, tous les jours
sauf le lundi)
Renseignements au 01 47 32 65 67.
Vernissage : samedi 20 septembre
2003 à 18h30.
L'exposition est réalisée par le service des Affaires
culturelles de Rueil-Malmaison, en collaboration avec l'Ambassade
de la République de Croatie à Paris et grâce
au soutien du Ministère croate de la culture et de la Ville
de Zagreb.
Préface
du catalogue de l'exposition
Par
Bozidar Gagro,
Ambassadeur de Croatie en France,
ancien ministre de la Culture
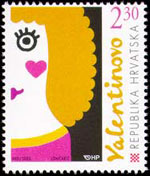 Le
drame de la Yougoslavie, ce pays, plus exactement, cet État
qui n’est plus, disparu comme il apparut : par la force
de l’histoire, celui-ci renferme en lui moments et périodes
qui furent autant d’instants de fierté et d’espoir.
L’un d’entre eux se produisit dans les années
cinquante et soixante, lorsqu’en Croatie et dans d’autres
milieux culturels de l’ex-Etat « des centaines de
fleurs ont éclos » selon une métaphore alors
fameuse. Et tout cela sur le décor monochrome que constituaient
le verbe assassiné et la pensée totalitaire. Le
drame de la Yougoslavie, ce pays, plus exactement, cet État
qui n’est plus, disparu comme il apparut : par la force
de l’histoire, celui-ci renferme en lui moments et périodes
qui furent autant d’instants de fierté et d’espoir.
L’un d’entre eux se produisit dans les années
cinquante et soixante, lorsqu’en Croatie et dans d’autres
milieux culturels de l’ex-Etat « des centaines de
fleurs ont éclos » selon une métaphore alors
fameuse. Et tout cela sur le décor monochrome que constituaient
le verbe assassiné et la pensée totalitaire.
| EXPOSITIONS
INDIVIDUELLES |
| 1964
Zagreb, Musée des Arts Décoratifs
(avec A. Jakic)
1969
Karlovac, Zorin dom
Zagreb, Galerie Inex
1970
Zagreb, Galerie d'Art Contemporain
Split, Galerie d’Art
Dubrovnik, Musée d’Art Contemporain
1971
Graz, Neue Gallerie
La Haye, Pavillon "Madurodam"
Zagreb, Galerie du théâtre
"Gavella"
1974
Zagreb, Galerie d'Art Contemporain
Dubrovnik, Galerie "Sebastijan"
Zadar, Maison "Grisogono" - Galerie
de l'Institut de la Préservation des Monuments historiques
1978
Zagreb, Galerie de l'Institut "R.
Boskovic"
1982
Rijeka, Galerie de Jadroagent
Varazdin, Atlas Art Agencija
Zagreb, Galerie d'INA
1983
Zagreb, Galerie "Fenêtres"
1986
Labin, Pazin, Porec, Rovinj
Zagreb, Musée des Arts Décoratifs
1987
Clermont Ferrand, Les journées yougoslaves
1988
Sibenik, Galerie “Krsevan”
Dubrovnik, Galerie du Centre International
d'Études Slaves
Cakovec, Musée de Medimurje
Zagreb, Bibliothèque Staglisce
1992
Zagreb, Galerie “Permanenta”
Slavonski Brod, Musée de Brodsko
Posavlje
1993
Cakovec, Galerie "Arh Gall"
Dubrovnik, Galerie "Sebastijan"
1996
Varazdin, Galerie "DoraArt"
1997
Zagreb, Galerie “ULUPUH”
Krk, Galerie "Decumanus"
Dubrovnik, Espace Matica hrvatska
Zagreb, Galerie Karas
Krapina, Galerie du Centre culturel
1998
Zagreb, Pavillon des Arts
1999
Dubrovnik, Galerie "Tezoro" (avec
Nives Cicin-Sain)
2001
Dubrovnik, Galerie "Artur"
2003
Koprivnica, Galerie Koprivnica et place
Zrinski
|
Dans
le microcosme culturel croate, héritier des grandes traditions
de l’entre-deux-guerres, et celle antérieure, de
la transition entre les XIXe et XXe siècles, l’effervescence
était à son paroxysme : les recherches étaient
tournées vers la modernité radicale, la synthèse
nationale, la revitalisation et la réappropriation du patrimoine.
Outre quelques artistes solitaires de stature internationale,
la Croatie a également engendré des collectifs artistiques
tels que les groupes « Exat 51 » ou « Nova tendencija
» (Nouvelle tendance) implantés à Zagreb où
s’est illustré la très ambitieuse « Biennale
de la musique contemporaine », ainsi que l’un des
fruits les plus originaux dans le domaine du film d’animation
– « l’École du film d’animation
de Zagreb », une des figures de proue de la créativité
artistique croate.
Fantaisie
ludique
Deux questions viennent aussitôt à l’esprit.
Pour quelles raisons tout cela est-il si méconnu en France
comme dans d’autres pays de la « vieille Europe »
? Et que convient-il faire pour qu’aujourd’hui la
réunification politique de l’Europe ne se fasse au
détriment d’une autre, culturelle, celle-là ?
Si l’on évoque ici ce sujet, ce n’est que pour
mieux préciser le cadre dans lequel s’inscrit le
profil d’un artiste qui est le produit authentique de son
milieu, qu’il a à sont tour enrichi par son expression
propre, et qui, à ce titre, mérite d’être
mieux présenté. Cependant, selon la fameuse logique
des tendances apparentées, son art deviendra comparable
au sein d’un courant largement universel tandis qu’il
rejoindra des individualités artistiques tels que la Française
Niki de Saint-Phalle, tout en n’ayant rien en commun ni
par ses origines ni par sa création.
Fait remarquable, Loncaric, dans son milieu culturel, ne constitue
pas un cas isolé. Il appartient à un cercle d’artistes
que caractérise une fantaisie ludique et ironique, un groupe
qui erra librement sans limites ni complexes de la peinture à
la sculpture, en passant par le film d’animation, la scénographie
de théâtre ou le design graphique. La plupart de
ces artistes ont été formés au début
des années cinquante à l’éphémère
Académie des arts appliqués de Zagreb, qui par sa
pratique pédagogique et la philosophie artistique qu’elle
recèle s’efforçait de libérer le potentiel
créatif individuel et d’atteindre les sphères
de la modernité expressive, faisant fi de l’abstraction
destructive, de la réduction et de l’annihilation
de toute forme de figuration.
Et tandis que sur la scène artistique se trouvaient au
premier plan, d’une part, les maîtres de l’abstraction
lyrique et géométrique, mais aussi une pléiade
de plasticiens tendant à la monumentalité, ou encore
des paysagistes doués réalisant à merveille
la synthèse de la tradition du genre paysager et des techniques
stylistiques modernes, et, tout à l’opposé,
les artistes naïfs de l’École
de Hlebine (« Hlebinska škola »)
qui, en s’inscrivant dans la mouvance du grand Douanier,
ont acquit une renommée mondiale, cet autre cercle d’amis,
modestes compagnons de route du renouveau, cherchait également
à sa manière à révolutionner l’esthétique.
Détail non négligeable, ils étaient à
la fois forts d’une bonne maîtrise technique et du
respect scrupuleux les lois de l’art plastique que leur
avaient inculqué leurs professeurs, maîtres d’une
autre époque, et suffisamment doués et conscients
des possibilités que portait en soi l’ère
de la modernité naissante.
| Son
art deviendra comparable au sein d’un courant largement
universel tandis qu’il rejoindra des individualités
artistiques tels que la Française Niki de Saint-Phalle,
tout en n’ayant rien en commun ni par ses origines
ni par sa création. |
Aussi
est-il d’autant plus intéressant de noter qu’aucun
nom collectif n’a été ni proposé ni
donné à ce courant, excepté dans le cadre
de l’École du film d’animation de Zagreb elle-même,
au demeurant artistiquement très proche, au sein de laquelle
quelques artistes, dont Zvonimir Loncaric, se distinguaient par
un style particulier. En effet, ils se différenciaient
suffisamment des autres et restaient proches par leur style que
cela aurait été amplement justifié. Ainsi
Jakic, Bourek, Lipovac ou Pejakovic, spécialement pour
le public et les critiques internationaux, n’évoquent-ils
tout au plus qu’un collectif ou quelques œuvres individuelles
qui peu à peu accèdent à une notoriété
venue tardivement couronner plusieurs décennies d’un
travail loin des feux de la rampe.
 Le
film d’animation
de Zagreb est une production authentique où se trouvent
synthétisée les différentes expériences
d’art plastique des années cinquante et soixante,
dont l’abstraction géométrique constitue une
des composantes relativement importantes. Aussi est-ce un des
premiers auteurs de dessin animé à Zagreb, Vlado
Kristl, membre du groupe Exat 51, qui incarne le mieux
ce lien direct. D’autres composantes se fondent davantage
sur le fond que sur la forme, c’est-à-dire qu’elles
procèdent d’un expressionnisme qui cultive le paradoxe
et l’ironie, l’humour noir et la déformation
des personnages, mais toujours d’une manière pathétique
et grave. Les anciens étudiants de l’Académie
des Arts appliqués y ont apporté leur propre richesse
reposant sur une intrigue et un jeu subtilement ironique, sur
une dérision plaisante et la réduction des formes
incarnant l’infantilisme, qui en réalité,
de la sorte, ne cherchaient délibérément
qu’à faire émerger leur propre originalité
stylistique et expressive. Le
film d’animation
de Zagreb est une production authentique où se trouvent
synthétisée les différentes expériences
d’art plastique des années cinquante et soixante,
dont l’abstraction géométrique constitue une
des composantes relativement importantes. Aussi est-ce un des
premiers auteurs de dessin animé à Zagreb, Vlado
Kristl, membre du groupe Exat 51, qui incarne le mieux
ce lien direct. D’autres composantes se fondent davantage
sur le fond que sur la forme, c’est-à-dire qu’elles
procèdent d’un expressionnisme qui cultive le paradoxe
et l’ironie, l’humour noir et la déformation
des personnages, mais toujours d’une manière pathétique
et grave. Les anciens étudiants de l’Académie
des Arts appliqués y ont apporté leur propre richesse
reposant sur une intrigue et un jeu subtilement ironique, sur
une dérision plaisante et la réduction des formes
incarnant l’infantilisme, qui en réalité,
de la sorte, ne cherchaient délibérément
qu’à faire émerger leur propre originalité
stylistique et expressive.
Capharnaüm
grand-guignolesque
Zvonimir Loncaric participa à la création du film
d’animation Surogat (Ersatz) de Dušan Vukotic, un chef-d’œuvre
en son genre, primé à Hollywood par un Oscar en
1961. Sa création parallèle à la fois en
peinture, en sculpture, et dans le film d’animation –
ce dernier ayant eut parfois des buts didactiques – se reflétait
indéniablement dans ses tableaux, et spécialement
dans ses sculptures, ce qui nous intéresse ici tout particulièrement.
De l’interaction des genres est née une cristallisation
fructueuse des idées : les procédés de Loncaric
sont parfaitement clairs. On peut à l’envi varier
le sens de ses personnages, de ses créations et de ses
compositions. Pour autant il est aisé de les décrire,
car elles s’imposent par leur propre caractère élémentaire
tant signifié que physique.
Au début, tout était de taille réduite, et
l’on aurait dit le monde des jouets : de petites figures
en bronze dépassant que rarement les vingt centimètres
de haut, et quand cela arrivait, l’auteur faisait tout son
possible pour éviter que nous ne songions à rapprocher
sa Femme étendue et la suggestive et monumentale plasticité
d’Henry Moore ; aussi, tout comme à d’autres
sculptures semblables, lui reliera-t-il les membres par des barres
métalliques, ou encore il fera, ailleurs, en sorte qu’ils
se métamorphosent en ailes battantes pour que finalement
tout finisse dans un grand-guignolesque capharnaüm en gestation
permanente (à l’image de l’atelier de l’artiste).
 C’est
alors qu’au début des années soixante-dix
se produisit une sorte de « Big bang » : ce qui
était petit devint grand, ce qui était de bronze
revêtit une ample coquille de polyester, ce qui était
coloristiquement neutre se pavana dans un acrylique résonnant.
Et summum du paradoxe, ultima ratio, l’antistyle devint
le style, l’artiste, par un simple détour qui relève
presque d’une boutade, prive la figure de sa signification
pour aussitôt lui en attribuer une autre. Mais quelle autre
? Si l’on suit la piste que nous dessinent les noms que
l’auteur lui-même leur a décernés, on
s’aperçoit qu’il ne s’agit que d’une
introduction au jeu qui nous est proposé, que d’une
métaphore suggestive, laquelle tend parfois à s’autodétruire
par pure tautologie, tant elle exprime ce qui est manifeste. Car
la forme peinte en bleu est nommée Bleu, alors
qu’une autre fois il nous surprend d’un clin d’œil
censé être mystérieux et qui nous semble pourtant
familier, en fait, banalement intime, un certain François
au bistrot, qui n’est malgré tout pas le vrai
François, car un oiseau est juché sur sa tête... C’est
alors qu’au début des années soixante-dix
se produisit une sorte de « Big bang » : ce qui
était petit devint grand, ce qui était de bronze
revêtit une ample coquille de polyester, ce qui était
coloristiquement neutre se pavana dans un acrylique résonnant.
Et summum du paradoxe, ultima ratio, l’antistyle devint
le style, l’artiste, par un simple détour qui relève
presque d’une boutade, prive la figure de sa signification
pour aussitôt lui en attribuer une autre. Mais quelle autre
? Si l’on suit la piste que nous dessinent les noms que
l’auteur lui-même leur a décernés, on
s’aperçoit qu’il ne s’agit que d’une
introduction au jeu qui nous est proposé, que d’une
métaphore suggestive, laquelle tend parfois à s’autodétruire
par pure tautologie, tant elle exprime ce qui est manifeste. Car
la forme peinte en bleu est nommée Bleu, alors
qu’une autre fois il nous surprend d’un clin d’œil
censé être mystérieux et qui nous semble pourtant
familier, en fait, banalement intime, un certain François
au bistrot, qui n’est malgré tout pas le vrai
François, car un oiseau est juché sur sa tête...
Milliers
de tambours
Les connaisseurs et les critiques souhaiteront savoir, d’une
part, dans quelle mesure ce changement découle de la contemporanéité
marquée par la percée de la figuration élémentaire
de l’art américain, également connu en Croatie
sous le nom de pop-art. Et de l’autre, dans quelle mesure
cette mutation correspond-elle à la trajectoire montante
et ininterrompue de l’inclination de Loncaric pour le jeu,
aux boutades et aux formes simplifiées qui à un
moment donné se sont transfigurées non dans l’esprit,
mais dans sa forme, son volume et sa couleur. S’il est question
de comparaison, laquelle s’impose d’elle-même
dans certains cas, notamment là où les formes sont
découpées et bidimensionnelles, on peut parler d’incitation
et d’encouragement des plus généraux aux effets
les plus concrets sur les couleurs et l’emploi de matériaux
plastiques légers et souples permettant de réaliser
à peu près tout ce qui peut jaillir de l’imagination
de l’artiste. C’est pourquoi ses œuvres réclament
aujourd’hui halls et places ou, mieux encore, prairies et
champs.
Cette dernière observation doit être prise avec réserve,
car, pour l’instant, trop rares sont les villes qui lui
ont prêté leurs esplanades ; quant aux prairies,
la seule et la plus belle est celle qui longe son atelier à
Novigrad Podravski. C’est là que l’on peut
véritablement tout saisir : qui il est et quelle est sa
quête ! On peut y sentir et réaliser comment, dans
le crescendo de ses idées, formes et couleurs artistiques,
résonnent les milliers de tambours des souvenirs d’enfance
qui, s’ils ont cessé depuis longtemps d’appartenir
à l’enfance, forment le prolongement de son regard
dans lequel il engloutit les traits uniformisés, graves
et mornes du quotidien, sans que pour autant l'artiste soit lui-même
nécessairement plus gai. Peut-être l’est-il
malgré tout, dans la mesure où ce monde s’est
montré fragile devant la dérision et le jeu prétendument
innocent de l’altération du sens, et dans la mesure
où Loncaric a fait preuve d’une domination et d’une
liberté que seul son talent artistique était à
même de lui offrir.
|