22/05/2003
ARCHÉOLOGIE
Salone,
capitale de la Dalmatie romaine
 A
l'occasion de la publication des deux tomes de l'ouvrage
Longae Salonae, l'archéologue croate
Emilio Marin, membre associé de l'Institut,
donnera à l'Institut d'Art et d'Archéologie
de Paris une conférence consacrée à
Salone, l'antique capitale de la province de Dalmatie,
dont les vestiges près de Split en font l'un
des sites majeurs de la romanité. A
l'occasion de la publication des deux tomes de l'ouvrage
Longae Salonae, l'archéologue croate
Emilio Marin, membre associé de l'Institut,
donnera à l'Institut d'Art et d'Archéologie
de Paris une conférence consacrée à
Salone, l'antique capitale de la province de Dalmatie,
dont les vestiges près de Split en font l'un
des sites majeurs de la romanité.
Programme
de la conférence
Allocution
d'ouverture
Bozidar
Gagro,
Ambassadeur de Croatie en France
Avant-propos
François
Baratte,
Professeur à l'Université de Paris
IV - Sorbonne
"Longae
Salonae, capitale de la Dalmatie romaine"
Emilio Marin, membre associé
de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres,
Directeur du Musée
archéologique de Split, Professeur associé
à l'Université de Paris IV-Sorbonne
Allocution
de clôture
Robert
Turcan, Membre de l'Institut, Professeur
émérite à la Sorbonne
Institut
d'Art et d'Archéologie de l'Université
de Paris IV-Sorbonne
Salle Doucet - 3, rue Michelet, 75006 Paris.
Jeudi 22 mai 2003 à 18 h.
Un
site archéologique majeur
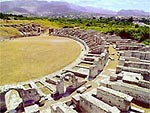 |
|
Les
ruines de l'amphithéâtre de Salone.
© MAS (Musée
archéologique de Split) |
Située
au carrefour des routes maritimes et terrestres,
Salone dut son essor à un site exceptionnel, au fond
de la baie de Kastela, en contrebas du versant ensoleillé
du Kozjak. Ses vestiges, qui en font l’un des grands
sites archéologiques de la romanité, se dressent
aujourd’hui à Solin dans la banlieue nord de Split.
C'est à Salone que s'éteignit en 480
l'Empire romain d'Occident.
Les
origines de la cité remontent au IIe
siècle avant notre ère. Après
n’avoir été qu’un modeste
port fortifié de la tribu illyrienne des Delmates,
situé à l’embouchure du Jadro,
elle fut colonisée par les Grecs d’Issa
(Vis), déjà établis à proximité,
de part et d’autre de la cité, à
Tragurion (Trogir) et Epetion (Stobrec).
Après sa victoire sur Pompée, en 48 av.
J.-C., César y envoya des colons italiques.
Colonia Martia Iulia Salona accéda
alors au rang de capitale de la province romaine de
Dalmatie. S’ouvrit alors une période de
paix et de prospérité jusqu’à
sa destruction par les Avars et les Slaves en 630.
 |
| Les
vestiges des thermes de Salone. © MAS |
Entre-temps,
Salone aura été la ville de l’empereur
Dioclétien (245-313), lequel se fit bâtir
non loin son immense palais où il se retira
en 305 après son abdication, et qui deviendra
par la suite le cœur de la future Split, aujourd’hui
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Alors même qu’elle fît partie de
l’Empire d’Occident après le partage
de l’Empire par Théodose, en 395, la Dalmatie
fut, en 437, accordée en dot impériale
à l’Empire d’Orient. Après
une brève période, elle devint un État
souverain (454-468) indépendant des deux Empires,
sous le général Marcellin. Son neveu,
Julius Nepos, régna sur la Dalmatie comme détenteur
du titre d’empereur légitime occidental.
Salone était alors sa capitale et la Dalmatie
le représentant de l’Empire d’Occident.
Aussi est-ce à Salone qu’avec la mort
de Julius Nepos (480) s’éteignit l’Empire
romain d’Occident.
 |
| Le
site de l'antique Salone.
© MAS |
Bâtie
selon un plan trapézoïdal allongé
(longae) délimité par une muraille,
la ville s’étendait sur 1600 m d’est
en ouest et sur 700 m du nord au sud. Jadis principale
métropole sur les rives orientales de l’Adriatique,
elle compta jusqu’à 60 000 âmes.
Depuis sa partie centrale, la plus ancienne (Urbs
vetus), elle s’est progressivement étendue
vers l’est (Urbs orientalis) et vers
l’ouest (Urbs occidentalis). Le tracé
de la voirie respectait un système orthogonal.
Mesurant 45 m par 70 m, le forum, avec son capitole,
était situé au centre de la cité,
sur le port. A l’ouest, le théâtre
bâti au Ier siècle, d’un diamètre
de 65 m, pouvait accueillir 3000 spectateurs. On peut
en voir un détail sur la représentation
de Salone sculptée sur la colonne de Trajan.
 A
l’extrémité nord-ouest de la ville,
l’amphithéâtre, le seul conservé
sur la rive est de l’Adriatique, avec celui de
Pula, date de la seconde moitié du IIe siècle.
De forme elliptique, il mesurait 125 m de long sur
100 m de large, pour une arène de 65 m sur 40 m,
et pouvait accueillir plus de 15 000 spectateurs, dont
13 500 assis. Au nord-est se dressaient les thermes
municipales, sur les ruines desquels furent par la
suite bâties les futures basiliques chrétiennes.
Des portes de la ville, seule subsiste aujourd’hui
la Porte de César, érigée à
l’époque augustinienne, qui s’ouvrait
à l’est sur le decumanus. Au
sud, l'aqueduc du Palais de Dioclétien, achevé
au début du IVe siècle, qui autrefois
alimentait le palais en eau, domine la vallée
entre Split et Solin. A
l’extrémité nord-ouest de la ville,
l’amphithéâtre, le seul conservé
sur la rive est de l’Adriatique, avec celui de
Pula, date de la seconde moitié du IIe siècle.
De forme elliptique, il mesurait 125 m de long sur
100 m de large, pour une arène de 65 m sur 40 m,
et pouvait accueillir plus de 15 000 spectateurs, dont
13 500 assis. Au nord-est se dressaient les thermes
municipales, sur les ruines desquels furent par la
suite bâties les futures basiliques chrétiennes.
Des portes de la ville, seule subsiste aujourd’hui
la Porte de César, érigée à
l’époque augustinienne, qui s’ouvrait
à l’est sur le decumanus. Au
sud, l'aqueduc du Palais de Dioclétien, achevé
au début du IVe siècle, qui autrefois
alimentait le palais en eau, domine la vallée
entre Split et Solin.
 |
| L'aqueduc
du Palais de Dioclétien. © MAS |
Le
christianisme, fut répandu très tôt
en Dalmatie : saint
Jérôme (v. 347-419), le traducteur
de la Vulgate, la Bible latine, y est né.
Auparavant, il fut surtout propagé par saint
Domnius (Dujam) et saint Anastase d’Aquilée
(Stas), tous deux morts en martyrs sous Dioclétien
à Salone, laquelle devint par la suite le siège
d’abord d’un évêché,
puis dès le Ve siècle, d’un archevêché.
Les nécropoles se développèrent
autour des sépultures des martyrs. Ce n’est
que plus tard, vers 650, que leurs reliques furent
transférées à Split dans l’ancien
mausolée de Dioclétien, devenu dès
lors la plus ancienne cathédrale du monde, alors
que par une ironie de l’histoire, l’empereur
fut le plus féroce persécuteur des chrétiens.
 Durant
le haut-Moyen Âge, après la destruction
de Salone, la vie se poursuivit à la lisière
orientale de la cité antique. Plusieurs souverains
croates furent inhumés dans l’église
de Gospin otok (Madone de l’Île) tandis
qu’en 1075, Dimitar Zvonimir fut couronné
dans l’église paléochrétienne
voisine. En octobre 1998, le pape Jean-Paul II s'y
est rendu à l'occasion de son deuxième
voyage en Croatie. Aujourd'hui, par son importance
au plan archéologique, Salone est considérée
comme le troisième site de la romanité. Durant
le haut-Moyen Âge, après la destruction
de Salone, la vie se poursuivit à la lisière
orientale de la cité antique. Plusieurs souverains
croates furent inhumés dans l’église
de Gospin otok (Madone de l’Île) tandis
qu’en 1075, Dimitar Zvonimir fut couronné
dans l’église paléochrétienne
voisine. En octobre 1998, le pape Jean-Paul II s'y
est rendu à l'occasion de son deuxième
voyage en Croatie. Aujourd'hui, par son importance
au plan archéologique, Salone est considérée
comme le troisième site de la romanité.
Sources
:
Longae Salonae, E. Marin (dir.),
Musée archéologique de Split, Split 2002.
Salona, Musée archéologique
de Split
Trésors artistiques de la Croatie ancienne,
I. Supicic (dir.), Somogy, Paris, 1999.
Guide Gallimard de la Croatie, Paris, 1999.
|