|
Le Monde
des Livres, 5/01/2002
DANS LA
PRESSE
L'engagement
et la cohérence
Mirko Grmek, médecin
et historien de la médecine, mort en mars 2000, ne séparait pas
travail scientifique et intervention politique
par Jean-Paul Thomas
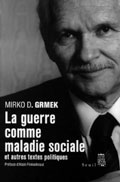 |
|
Mirko D. Grmek, "La guerre comme maladie sociale et autres textes politiques". |
La Vie,
les maladies et l'histoire réunit la traduction d'entretiens accordés
par Grmek en 1998 à un journaliste italien, une esquisse biographique due
à Louise Lambrichs et une bibliographie chronologique. Le second volume,
La Guerre comme maladie sociale, présente les articles de presse qu'il
consacra à la Croatie, sa nation d'origine, au cours de la guerre en ex-Yougoslavie.
Le rapprochement des titres suggère une unité thématique,
que souligne Louise Lambrichs en dégageant "la cohérence de
cette existence extrêmement riche, placée sous le signe de l'engagement
et d'une quête lucide de la vérité". La valeur documentaire
de ces deux ouvrages est indéniable. Mais la volonté de faire le
lien entre l'historien des sciences biomédicales et l'auteur de Nettoyage
ethnique, documents historiques sur une idéologie serbe est moins convaincante.
Qu'un tel lien existe est avéré ; en préciser la nature n'est
pas chose aisée.
La cohérence
vécue est hors de doute. Elle est celle d'un chercheur dont la curiosité
dominante était de type scientifique, mais qui avait choisi d'étudier
la médecine parce qu'elle est le pont qui unit les deux cultures, littéraire
et scientifique, et qu'il espérait "apprendre tout ce qu'on peut savoir
sur la nature et sur la condition humaine". Elle est aussi celle d'un démocrate
militant, qui confie avoir été poussé vers l'histoire de
la médecine par goût de l'indépendance et aversion pour les
hiérarchies, et dont l'engagement contre la purification ethnique fait
écho à son engagement contre la dictature nazie. Louise Lambrichs,
dans son élégante introduction biographique, insiste sur cette unité
vécue.
| MIRKO
D. GRMEK |
|
Né
en Croatie en 1924, Mirko Grmek, engagé dans
la Résistance au cours de la dernière guerre, fut professeur à
la faculté de médecine de Zagreb, ville où il fonda et dirigea
l'Institut d'histoire des sciences. Installé en France - il sera naturalisé
en 1967 -, il fut chargé de recherche au CNRS, puis directeur d'études
à l'Ecole pratique des hautes études. Il est l'auteur de nombreux
ouvrages, dont Le Raisonnement expérimental et recherches toxicologiques
chez Claude Bernard (1973), Histoire du sida (1989), Histoire de la pensée
médicale en Occident (3 vol. 1995-1999). Il est mort le 6 mars 2000.
|
La cohérence
politique est celle d'un patriote, Croate de naissance, qui tente de convaincre
ses interlocuteurs, notamment les intellectuels français, des insuffisances
de la Communauté européenne et de l'aveuglement du gouvernement
français, qui persiste dans ses efforts pour préserver l'intégrité
de la Yougoslavie. Tout à son combat pour établir que le nettoyage
ethnique fait partie de l'idéologie grand-serbe, Mirko Grmek est moins
attentif à la manipulation du nationalisme dans son propre pays. Bien que
critique à l'égard de Franjo Tudjman, il n'a pas pris l'exacte mesure
de son exaltation d'une grande Croatie, de sa mainmise sur les médias,
de son harcèlement de l'opposition. Dix ans après, au moment où
Slobodan Milosevic s'apprête à rendre compte de ses crimes devant
le Tribunal pénal international de La Haye, une juste appréciation
des effets dévastateurs de l'exacerbation des nationalismes, en Serbie
mais aussi en Croatie, est possible et nécessaire.
Le bref
et vif dialogue entre Mirko Grmek et Ivan Djuric, jeune historien serbe hostile
à Milosevic, publié en 1993 dans Globe Hebdo, illustre mieux l'extrême
difficulté, pour des intellectuels de bonne foi appartenant à des
nations en guerre, d'une prise en compte équitable des responsabilités
historiques de leurs compatriotes et de leurs dirigeants. L'histoire, lorsqu'elle
est celle du temps présent, rencontre d'autres problèmes que ceux
de l'histoire des sciences médicales.
C'est pourquoi
la cohérence théorique de l'œuvre de Grmek n'est pas déplacée
par ce recueil d'articles. Ni la mise en exergue du recours à la méthode
historique pour analyser les documents qui établissent l'ancienneté
de l'idéologie serbe du nettoyage ethnique ni le recours aux notions de
maladie et de pathologie sociale pour penser la guerre n'en affectent l'économie
d'ensemble. Le centre de gravité de cette œuvre de premier plan, ce
sont les études bernardiennes ; son accomplissement éditorial, la
monumentale Histoire de la pensée médicale en Occident. Le recours
à l'analyse des grandes épidémies du passé pour expliquer
la pandémie du sida et les ultimes réflexions sur l'occultation
de la mort dans les sociétés industrielles en forment les dernières
percées théoriques.
|